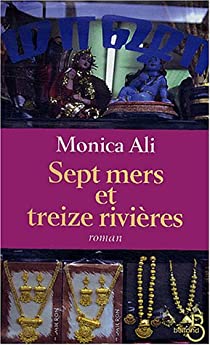
Monica Ali vit à Dulwich, au sud-est de Londres. Son livre, paru sous le titre anglais de « Brick Lane » (Allée de briques) (nom tiré d’un quartier qui tient une place de choix dans son récit) a été, au Royaume-Uni, un des événements littéraires majeurs en 2003. Pourtant, c’était là son premier et à ce jour son unique roman. Et, fait rarissime, alors qu’elle n’avait que 35 ans, et que son ouvrage n’était encore qu’à l’état de manuscrit, elle a été sélectionnée, par la revue « Granta » parmi les meilleurs écrivains britanniques de la décennie. Une fois publié, « Brick Lane » a été traduit dans une quinzaine de langues ; finaliste du « Man Booker Prize » ; lauréat de nombreux prix littéraires. Et l’auteur a été saluée à l’égal de Zadie Smith, une jeune Anglo-Jamaïcaine qui fit sensation en 2000, avec son livre "Sourires de loups".*
*J’ai donc lu également cet ouvrage. Et s’il est vrai que les deux auteures ont en commun leur jeunesse et leur enracinement dans leur civilisation originelle, Sourires de loups est beaucoup plus extraverti, moins pudique, un tantinet ironique avec parfois une pointe de vulgarité. Il est plus largement socio-philosophique, traitant, lui, des communautés jamaïcaine et indienne. Par contre, si « Sept mers… » est vu essentiellement du point de vue des femmes, Sourires de loup est traité à travers les hommes. Mais les femmes y ont « pris » davantage de liberté. Et lorsque sont évoqués les problèmes sociaux (violentes émeutes des jeunes Pakistanais à Bradford et Oldham…), ils le sont à l’échelon national, au lieu de demeurer dans la vie communautaire…
L’autre point commun à ces deux jeunes écrivaines, consiste en une rare maîtrise de l’écriture et un sens aigu du roman. Chacun de leurs livres est un véritable documentaire sur leurs communautés respectives plongées dans les mêmes problèmes d’intégration. Et la vie des protagonistes y est « créée » avec une acuité et une véracité remarquables. Donc, si vous avez aimé "Sept mers et…", vous aimerez également "Sourires de loup"."
Revenons à Monica Ali. Le succès ne semble pas avoir changé son mode de vie simple et convivial, où la famille conserve le premier rang. Il n’est donc pas étonnant qu’elle regrette le changement de titre, devenu en français Sept mers et treize rivières». Plus poétique que « Brick Lane » qui situait l’ouvrage dans un milieu social sans ambiguïté, cette appellation tend par contre faussement à suggérer que le livre se situe dans un contexte fantasmagorique, alors qu’il plonge d’un bout à l’autre dans un quotidien on ne peut plus terre à terre. L’expression Sept mers et treize rivières est tirée d’une phrase qui, au Bangladesh, débute les contes pour enfants. Elle apparaît dans une lettre de la sœur de Nazneen, l’héroïne : « Tu te rappelles ces histoires qu’on nous racontait quand on était petites ? Elles commençaient par il était une fois un prince qui vivait dans un pays lointain de l’autre côté de sept mers et treize rivières ».
« Brick Lane » est le nom d’une rue de l’East-End londonien, au cœur de ce que les Anglais nomment « Banglatown » (la Ville bangladaise). Réputée pour ses spécialités et ses restaurants exotiques, Brick Lane est devenue si célèbre depuis la parution du livre de Monica Ali, que la ville de Dacca où elle est née a rebaptisé de ce nom l’une de ses rues ; et qu’un restaurant indien de Manhattan l’a également adopté. Mais, si le « côté rue » semble avoir changé, si un certain clinquant touristique s’est instauré, la population des rues adjacentes a conservé son esprit originel, où règnent racisme ordinaire, fondamentalisme rampant, trafics en tous genres, débrouillardise et exploitation, misère et rêves avortés.
Monica Ali** est née en 1967, à Dacca, ville de l’ancienne province orientale du Pakistan. En 1971, (elle a donc 4 ans) éclate la guerre entre Inde et Pakistan, à propos de la révolte du Bengale. Sa famille (père bangladais et mère anglaise) émigre en Angleterre, à Bolton dans les Midlands. Son père est employé dans une usine sidérurgique. L’enfant grandit, constamment ballottée entre une communauté bangladaise ancrée dans ses us et coutumes ; et la société anglaise. D’où le sentiment de n’appartenir ni à l’une ni à l’autre ; d’être sans cesse en position d’ « outsider ».
Très jeune, elle est une élève brillante et une lectrice infatigable. Au point d’avoir lu, à 13 ans, tous les ouvrages de Jane Austen. Elle entre à Oxford pour y étudier la philosophie et les sciences politiques. Toujours consciente de sa situation marginale, « venant non pas d’Oxbridge, mais d’un milieu ouvrier », elle s’applique à paraître « aussi sophistiquée et sûre d’elle que ses camarades ». L’indépendance d’esprit que lui confèrent ses études, lui permet de mûrir socialement et intellectuellement. Quand elle quitte l’université, elle est prête, enfin, à assumer ses racines. Elle se documente sur les émeutes de ceux que les Anglais appellent les jeunes « Paki » à Bradford et Oldham, en 2001 ; et sur la situation des ouvrières du textile à Londres et à Dacca, tous événements sur lesquels elle projette d’écrire un essai. Mais d’abord, elle écrit une œuvre romancée.
Ce livre, c’est « Brick Lane », « Sept mers et treize rivières » : Une jeune villageoise bangladaise, Ruplan, est enceinte de sept mois. Elle est en train de plumer un vieux poulet coriace, l’un des derniers à avoir résisté à une vague de chaleur sans précédent. Elle mène avec ce poulet, une conversation animée. Soudain, elle a « l’impression qu’une poigne d’acier lui comprime les entrailles… Corps chauffé à blanc, flots de sang rouge ; Ruplan hurl(e)». Toujours agrippée au poulet et à l’épaule de Mumtaz sa mère, cependant que son mari affolé court chercher Banesa la sage-femme, elle accouche d’une fillette parfaitement constituée, mais qui semble mort-née. La sage-femme commence à préparer le bébé pour l’enterrement, lorsqu’un cri s’élève : la petite n’est pas morte. Mais pendant des jours, elle sera en danger, car elle repousse le sein de sa mère. Laquelle refuse les conseils des autres femmes qui veulent l’hospitaliser. Elle rétorque : « Nous ne devons pas influencer le cours du destin. Quoi qu’il arrive, je l’accepte. Mon enfant ne gaspillera pas son énergie à lutter contre le Destin ».
Le Destin ! Pendant toute son enfance, la fillette que l’on a appelée Nazneen, entendra raconter « comment tu as été confiée à ton Destin ». Elle apprendra que « Ce qu’on ne peut pas changer doit être enduré. Et comme rien ne peut être changé, il faut tout endurer ». Ce principe gouvernera pendant très longtemps son existence. Au point qu’après avoir failli mourir à sa naissance, elle se sent psychologiquement mourir une seconde fois, à vingt ans, lorsque son père, brisé par la fuite de sa sœur Hasina, décide de la marier. Mais même alors, bien que terrifiée parce qu’il va lui faire épouser un homme dont elle ne sait rien, sauf qu’il est « vieux, au moins 40 ans et ressemble à une grenouille, et qu’il l’emmènera en Angleterre où il vit », Nazneen, contrairement à sa sœur, est incapable de se rebeller. Après le mariage, installée depuis quelques semaines en Angleterre, elle entend par hasard une communication téléphonique, où son mari la définit ainsi : « C’est une bonne travailleuse. Elle n’est pas corrompue. C’est une fille du village ». De son côté, elle se dit que son père « (n’a) pas fait un si mauvais choix. Chanu (son mari) n’(est) pas méchant. Il ne la (bat) pas. Elle (pourra) sans doute l’aimer». Mais il a des principes bien arrêtés sur le rôle des femmes : ainsi ne voit-il pas l’intérêt pour elle d’apprendre l’anglais puisqu’elle ne sort pas ; et pas l’intérêt de sortir puisqu’il lui apporte tout ce dont elle a besoin. A mesure qu’elle fera l’impossible pour échapper à l’impuissance décisionnelle où il l’a confinée, elle comprendra qu’il est lourdaud et peu délicat, lâche, velléitaire, confit dans son égocentrisme et sa culture, imperméable à celle de son pays d’accueil.
Commence alors la vie anglaise de la jeune Bangladaise. La vie anglaise ? Peut-on définir ainsi une existence où elle a pour seuls horizons d’autres Bangladais installés derrière des murs de briques, et « la brise chargée de relents nauséabonds provenant de poubelles communales pleines à ras bords » ? Et à chaque réveil, « le visage bouffi de Chanu sur l’oreiller près d’elle… la coiffeuse rose et la monstrueuse penderie occupant la plus grande partie de la pièce ». Alors que, de la vie anglaise elle ne sait à peu près rien ; et de la langue ne connaît que deux mots « Excusez-moi » et « Merci ».
Page à page, le lecteur va suivre le cheminement de Nazneen. Ses fascinations. Par exemple pour le patinage qu’elle prononce « aretistique » ; qu’elle regarde pendant des heures et dont l’impression de liberté gestuelle l’accompagnera longtemps, dans l’exiguïté de son cadre de vie. Ses intérêts et ses rejets. La prise de conscience croissante que l’ « on peut s’épanouir au-dessus d’une rizière, on peut chuchoter quelques mots à un manguier, on peut sentir la terre sous ses pieds en sachant que tout commence et s’achève là. Mais que pourrait-on dire à un tas de briques» ? Cette sorte de désespoir muet, de nostalgie va s’exacerber jusqu’au jour où n’en pouvant plus, elle s’enfuit de l’appartement, se hâte bien qu’enceinte, au long des rues inconnues et hostiles, erre folle d’angoisse… Sa première fierté tiendra au fait d’avoir, dans un café où elle est entrée pour aller aux toilettes, su en anglais, demander son chemin ! Quant au cercle qui constitue son « monde extérieur », il est très restreint. Elle ressent une fascination admirative et un peu effrayée pour sa nouvelle amie, Razia, bien décidée, elle, à s’intégrer à la vie anglaise ; une peur instinctive à l’égard de Mme Islam, malade professionnelle et usurière. La présence délétère de cette femme amène Nazneen à lui résister, refusant de lui confier son enfant ; alors que Chanu juge cette personne exceptionnelle et la laisse s’immiscer dans leur vie de couple. Quelques amitiés sporadiques naissent, avec des femmes complètement déconsidérées dans cette société moralement autarcique, parce qu’elles ont le courage de travailler à l’extérieur, ou de sortir faire leurs courses ! Sa seule détente est en somme la télévision à travers laquelle Nazneen aspire de plus en plus à sortir de la médiocrité, s’ouvrir vers l’extérieur.
Avec la naissance de son fils, la vie de la jeune recluse change. Elle voue à cet enfant un amour absolu. Hélas ! Il meurt. Le désespoir et la solitude se font de plus en plus lourds. Deux filles (Shahana et Bibi), nées au cours des années suivantes lui apporteront un peu de soulagement et d’amour, même si très vite elles se désolidarisent de sa vie tellement passive, en marge de la civilisation anglaise. Le père s’intéresse peu à elles, sauf pour leur raconter l’histoire du Bangladesh et leur lancer les mêmes interdits et les mêmes impératifs qu’à son épouse.
De réalité souvent sordide en rêve du pays ré-imaginé, d’un quotidien centré sur des tâches ménagères dans son appartement minable en souvenirs idéalisés ; de désillusions tour à tour émouvantes voire poignantes, amusantes ou vulgaires ; d’inquiétudes pour l’avenir de son foyer en inquiétudes pour sa sœur Hasina qui mène au Bangladesh une vie très instable, dont le lecteur connaît les détails par ses lettres vivantes et naïves… Nazneen émerge de cette sorte de non-existence, et se dit soudain « Si j’étais du genre à faire des vœux, je sais ce que je souhaiterais »… Mais chaque fois, reprennent le dessus, le quotidien des préparations épicées, des chaussettes sales, des cors du mari à couper ou des papiers décollés, l’égocentrisme forcené de Chanu obnubilé par ses diplômes de pacotille, et dégoulinant de vacuité au cours de ses soliloques pompeux ! Face à l’omniprésence de cet homme que le lecteur juge tour à tour pitoyable et exécrable, il est fascinant de suivre l’éveil de la conscience de la jeune femme tiraillée entre deux pôles totalement opposés ; de cette intelligence jusque-là si peu sollicitée ; de cette faculté jusqu’alors refusée, de juger de ce qui peut être bon pour elle et sa famille.
Les réactions des fillettes vont accélérer cet éveil spirituel, fixer sa volonté, l’amener à tenter de lutter contre leur pauvreté en obligeant son mari à lui acheter une machine à coudre pour effectuer un travail à domicile –C’est là le premier acte véritable de son émancipation, même s’il nous apparaît bien dérisoire-. Certes, elle s’échappe parfois, en particulier pour assister à des réunions politiques dont seul le hasard lui a fait connaître l’existence. Mais, si elle en perçoit les luttes intestines entre protagonistes, elle ne saisit pas les graves implications politiques et religieuses de ces réunions. Et comme elle n’a personne avec qui en discuter, Nazneen est finalement toujours aussi coupée du monde. Pourtant, progressivement, son intérêt croît pour les événements extérieurs où se développe l’intégrisme ; où règne le chômage ; où sévit la drogue (dont est victime en particulier le fils jusque-là modèle de Razia). Dans le même temps –et peut-être paradoxalement responsable de ces nouveaux questionnements- la venue quotidienne du jeune livreur de vêtements va faire prendre à Nazneen également conscience de son corps. Des désirs surgissent, depuis toujours insoupçonnés. Une relation sexuelle s’instaure entre elle et le jeune homme. Mêlant plaisir et culpabilité.
Jusqu’au jour où elle se rend compte qu’elle est tombée de Charybde en Scylla ! Que ce jeune Islamiste véhicule en plus violents les mêmes tabous que Chanu ; auxquels s’ajoute un intégrisme grandissant, attesté par l’adoption des signes extérieurs de ce nouvel état d’esprit (cheveux longs, port de la barbe, vêtements…). Elle réalise qu’elle n’a finalement aucune envie de divorcer de son mari pour se retrouver dans un enfermement pire que l’actuel. Elle trouve, au cours d’une scène très pénible, le courage de mettre fin à cette liaison qui lui apparaît de plus en plus pitoyable.
Pendant ce temps, la tension croît au foyer. Chanu, toujours plongé dans ses rêves, a démissionné de son travail, et s’est lourdement endetté vis-à-vis de Mme Islam. Laquelle multiplie les chantages et menace de faire intervenir ses gros bras de fils, pour se faire rembourser toujours plus. Jusqu’au jour où, au bout de longs mois, son mari se révélant comme d’habitude inapte à faire face à la situation, Nazneen décide de se rebeller et de ne plus rien rembourser. Aucune intimidation pourtant très concrète de la famille Islam ne peut la faire changer d’avis.
Mais, autre menace également très concrète, Chanu, d’habitude si velléitaire, a décidé de rentrer au Bangladesh, et rien ne semble devoir infléchir sa décision. Les deux fillettes refusent de partir, et Nazneen, bien que mourant du désir de revoir sa sœur, n’en a pas non plus la moindre envie. Finalement, la date de leur départ est fixée, les billets achetés. L’exaspération devient si forte que Nazneen s’évanouit et reste inconsciente pendant plusieurs jours. Le Docteur Azad, dont la relation à Chanu, est des plus étranges va la remettre sur pied. Mais, bien que soucieux de son état et pour une fois très attentif, le mari continuant de faire les demandes et les réponses, et de pratiquer le chantage, est incapable de comprendre les raisons de sa détresse !
Lorsqu’elle reprend ses sens, Nazneen peut enfin formuler un désir : Désormais, « moi seule déciderai de ce que je dois faire. Moi seule déciderai de ce qui va arriver. Moi seule. Une sensation pareille à une décharge électrique la parcourut, et elle cria de jubilation ». Subsiste néanmoins la peur que cette décision qu’elle veut irrévocable, ne résiste pas à la pression qu’immanquablement, Chanu exercera sur elle. Elle décide donc de ne l’informer qu’en dernière minute qu’elle a choisi de rester en Angleterre avec ses filles, et qu’il rentrera seul au pays. Les derniers jours s’écoulent sur fond de manifestations pro- et anti-islamiques ; de lutte désespérée pour aider Razia à désintoxiquer son fils ; de résistance de Shahana et Bibi, bien décidées à ne pas partir ; d’impuissance de Nazneen à les rassurer de crainte qu’elles ne trahissent le secret.
Shahana, persuadée qu’on l’emmènera contre sa volonté, s’enfuit, après avoir fait jurer à sa sœur de ne rien dire. Mais la petite ne peut résister aux questions inquiètes de leur mère qui part à la recherche de sa fille, au long des rues envahies de manifestants. Priant, pleurant, trébuchant, l’angoisse lui fait trouver assez de mots anglais pour expliquer aux policiers qu’elle doit se rendre dans un certain café de Brick Lane… Elle finit par y trouver sa fille et la ramène chez elle en promettant d’arranger les choses.
Arrive le jour du départ. Le lecteur assiste à la première scène intime du couple, et c’est plus celle d’une mère berçant son enfant dont il s’agit, que d’une épouse imposant finalement sa volonté. Mais il apparaît qu’intuitivement Chanu avait pressenti ce qu’elle allait lui annoncer ! A savoir qu’elle ne « peut » pas partir. « Et moi, je ne « peux » pas rester », chuchote-t-il. C’est lui qui annonce aux filles qu’il part seul. Les apparences sont sauves.
La vie s’organise en deux lieux distants de milliers de kilomètres. Au fil des appels téléphoniques, il est vite évident que les affaires de Chanu sont là-bas ce qu’elles étaient à Londres, périclitantes du fait de ses rêves fallacieux. Par contre, c’est une vie de travail riche de création pour Nazneen. Elle imagine des modèles de sacs et de vêtements que réalisent Razia et leurs amies, à qui elles se sont associées. Leur affaire bien organisée leur permet de vivre confortablement. Parallèlement à la vie londonienne de Nazneen, s’égrènent les nouvelles qu’Hasina s’est de nouveau enfuie, cette fois avec le cuisinier de ses patrons ; que les deux fillettes travaillent très bien ; que le fils de Razia est guéri. Une existence toute neuve débute, harmonieuse, épanouie.
Et un jour, Razia et les enfants qui ont enfin compris les aspirations de leur mère, emmènent Nazneen en grand mystère vers un lieu secret. Lorsqu’elle a enfin le droit d’ouvrir les yeux, « Tiens, Maman, voilà tes patins », dit Shahana. « Mais on ne peut pas patiner en sari », s’exclame-t-elle. « On est en Angleterre » réplique Razia. « Ici, tu peux faire tout ce que tu veux ». C’est sur cette vision peut-être un peu idyllique que s’achève la saga anglo-bangladaise de Monica Ali.
Sept mers et treize rivières est un livre magnifique, mêlant de façon très maîtrisée amour, amitié, apprentissages et coutumes, ethnologie… L’héroïne en est touchante ; capable, bien que venant du village le plus reculé et traditionaliste du Bangladesh, de s’ouvrir à un « ailleurs » tout en restant fidèle à ses racines. Contrairement à l’épouse du Docteur Azad, par exemple, qui se veut plus « anglaise » que les Anglais. Différemment de Razia qui, elle, essaie de s’intégrer jusqu’à demander la nationalité anglaise. Et tout en sachant qu’il lui faut payer au prix fort, ses choix et son émancipation (ne pas revoir sa sœur, entre autres, ce qui lui est le pire crève-coeur).
Sept mers et treize rivières est un roman au cœur de vies de femmes parvenues à la croisée des chemins, tiraillées, face à l’obligation de faire des choix, entre traditions et révolte. Un ouvrage d’une actualité brûlante, où s’entrelacent les souvenirs, la nostalgie du pays d’origine, ses paysages, ses couleurs, ses odeurs, ses gens… et la violence psychologique, l’intolérance religieuse qui vont croissant insidieusement ; accentuant la tristesse, la solitude et l’anonymat de l’univers de briques où sont transplantés ces immigrés.
Sept mers et treize rivières est un livre totalement introverti, plein d’émotion, de vérité sociale, religieuse, politique ; et de pertinence sur la communauté bangladaise et indienne, à la fois en marge et immergée dans la vie anglaise. Une écriture étincelante, parfois psychologiquement pesante, la plupart du temps pleine de fraîcheur, de tendresse et d’humour, toujours très impliquée. Ce qui génère un roman compréhensif, foisonnant et précis, sur le choc des cultures, les désappointements et les mirages de l’intégration. Une vision tellement juste, pleine d’acuité ; et une galerie de portraits si réaliste que les compatriotes de l’auteur ont condamné cette appréciation acide, sans illusions et sans complaisance de leur microcosme ; alors que, comme nous l’avons dit au début, les communautés étrangères l’ont encensée.
Jeanine RIVAIS
Sept mers et treize rivières : MONICA ALI. Traduit de l’anglais par Isabelle Maillet. Editions Belfond 460 pages. 20,60 €
*paru en français chez Gallimard et dans la Collection folio.
** Détails biographiques empruntés à Florence Nolville. Le Monde des livres.
PAKISTAN. BENGALE. BANGLADESH.
Après que se fut instaurée, sous la Reine Victoria, la prépondérance anglaise, l’Inde devint partie du Commonwealth, mais les Anglais durent affronter des troubles endémiques, des manifestations autonomistes qui furent généralement brutalement réprimés. Le personnage le plus symbolique fut Gandhi qui, en 1935, obtint une certaine autonomie pour l’Inde. Mais alors, les luttes entre musulmans et Hindous s’accentuèrent. Et, en 1947, l’Angleterre dut accepter la division de l’Inde en deux dominions : le Pakistan musulman ; et l’Union indienne peuplée surtout d’Hindouistes ; la province appelée Bengale étant partagée entre l’Inde et le Pakistan.
Cette scission ne fut jamais satisfaisante. Plusieurs guerres opposèrent, opposent toujours d’ailleurs, l’Inde, le Bengale, le Cachemire et l’Afghanistan. Elles conduisirent en 1971, à un afflux en Inde, de millions de réfugiés, surtout des Hindous, fuyant l’intolérance islamique, et incapables de subsister dans ces régions surpeuplées et pauvres sans cesse ravagées par la guerre. Cette migration généra de nouveaux troubles entre l’Inde et le Pakistan et provoqua la sécession du Pakistan oriental qui devient la nation indépendante du Bangladesh (= Bengale libre).Libre et indépendant, mais l’un des pays plus pauvres du monde ! D’où une continuité dans le flux migratoire de ces miséreux cherchant à atteindre le mirage de la réussite.
En 1950, l’Union indienne devint une république fédérale.
En 1972, le Pakistan se retira du Commonwealth.
Mais malgré l’indépendance enfin conquise de ces états, il semble bien que, comme pour nous les Africains, le nombre des émigrants n’ait jamais baissé à destination de l’Angleterre. Y compris via la France, puisque la triste histoire de Sangate est très présente dans tous les esprits.
Du Bengale, nous connaissons surtout Calcutta, la gigantesque métropole, et Darjeeling dont les collines sont célèbres pour leur production de thé.
Malgré son extrême pauvreté, le Bangladesh possède une culture distincte (ainsi, de nombreux intellectuels en sont-ils originaires, dont le poète Rabendranath Tagore et le cinéaste Satyajit Ray) ; un artisanat indigène spécifique (saris de soie…)
La capitale est Dacca :10,3 Mm d’habitants.
Peuplement : 131 Mm d’habitants
Langue ; essentiellement le bengali.
La revue GRANTA : Prestigieuse revue anglaise, créée à l’origine par des étudiants.
Elle publie tous les dix ans, sa liste très attendue des jeunes espoirs littéraires de la décennie. En ont fait partie Monica Ali qui nous intéresse aujourd’hui, Zadie Smith que nous allons évoquer pour son ouvrage Sourires de loups, et Salman Rushdie qu’il n’est pas besoin de présenter.
. CE LIVRE A ETE PUBLIE DANS LE N° 53 D'AVRIL 2005 DE LA REVUE DE LA CRITIQUE PARISIENNE.
 le site artistique de jeanine rivais
le site artistique de jeanine rivais